XXe-XXIe siècles
-
-

TABLES DES MATIERES
(Volume premier)
Avant-propos
Remerciements
Les sources du tome II
Introduction générale
Première partie : Qui possède et qui dirige la société générale ?
Chapitre II. Le contrôle du capital : les " noyaux durs " de la démocratie mobilière
Chapitre III. Les administrateurs de la Société générale
Chapitre IV. L’exercice de la fonction présidentielle
Chapitre V. Dorizon directeur de la Société générale
Chapitre VI. Structuration et renouvellement de la direction
Chapitre VII. Une direction adaptée à une grande entreprise
Conclusion de la première partie
Deuxième partie : La Société générale, grande banque de dépôts
Introduction
Chapitre VIII. La stratégie de la banque de dépôts à réseau de guichets
Chapitre IX. Le déploiement du réseau de guichets
Chapitre X. Les directeurs d’agence, levier de l’expansion de la banque de réseau
Chapitre XI. Les qualités et les valeurs des directeurs d’agence
Chapitre XII. L’Inspection générale et le contrôle des agences
Chapitre XIII. La collecte des dépôts : croissance et compétitivité
Troisième Partie : L’essaimage de la banque de dépôts hors de France
Chapitre XIV. La Société générale en Allemagne : la Sogénal
Chapitre XV. Une filiale bancaire en Russie : la Banque du Nord (1901-1910)
Chapitre XVI. Les déceptions procurées par une filiale mal gérée
Chapitre XVII. Un déploiement stratégique d’envergure : la Banque russo-asiatique (1910-1918)
Chapitre XVIII. La Société générale marraine de la Banque de Salonique
Quatrième Partie : La banque des « capitalistes » : banque de patrimoine et courtage de titres
Chapitre XIX. Un métier clé : la banque de patrimoine
Chapitre XX. La banque de patrimoine, une machine à placer des titres
Chapitre XXI. La banque de patrimoine en action : " les services capitalistes "
Chapitre XXII. La structuration et la densification d’une organisation de firme
Chapitre XXIII. La gestion des ressources humaines
Chapitre XXIV. La Société générale et l’égalité des chances : entre philosophie sociale et réalité
Chapitre XXV. L’expression progressive d’une politique sociale ?
Cinquième partie : La gestion de l’organisation de firme bancaire
Chapitre XXII. La structuration et la densification d’une organisation de firme
Chapitre XXIII. La gestion des ressources humaines
Chapitre XXIV. La Société générale et l’égalité des chances : entre philosophie sociale et réalité
Chapitre XXV. L’expression progressive d’une politique sociale ?
Sixième Partie : Une belle image de marque
Chapitre XXVI. Une ascension consacrée par le prestige de l’immobilier
Chapitre XXVII. La communication institutionnelle de la Société générale : la consécration d’une marque bancaire
Conclusion générale du volume premier
Liste des légendes
--(volume II)
Introduction générale
Première partie : La banque commerciale de crédit, clé de voûte de la banque d’entreprise
Chapitre premier. Le déploiement de la banque commerciale : entre stratégie et clairvoyance
Chapitre II. La Société générale, banque d’entreprise en France
Chapitre III. Le régionalisme bancaire dans les cités-ports de l’Atlantique
Chapitre IV. La Générale à la conquête de la cité-port marseillaise
Chapitre V. La Société générale au coeur de places industrielles et commerciales
Chapitre VI. La Générale chasse sur les terres du Lyonnais
Chapitre VII. La Sogénal : l’affirmation d’une banque d’entreprise régionale
Chapitre VIII. La Générale, soutien de moyennes entreprises en région ?
Chapitre IX. La Société générale, banque d’affaires en France ?
Chapitre X. La Générale accompagne la deuxième révolution industrielle
Chapitre XI. Banque de marchés et gestion d’actifs
Deuxième partie : Le déploiement de la banque d’entreprise et d’affaires hors de France
Chapitre XII. La Société générale, banque impériale ?
Chapitre XIII. La banque d’entreprise et d’affaires en Europe de l’Ouest
Chapitre XIV. La Générale entre le Danube et les Balkans
Chapitre XV. La Société générale et l’Empire ottoman
Chapitre XVI. La Société générale, banque d’entreprise et d’affaires en Russie
Chapitre XVII. La diversification des affaires russes
Chapitre XVIII. Le paradoxe d’une banque de plus en plus russe : de l’impérialisme français à l’impérialisme russe ?
Chapitre XIX. La Société générale, banque d’affaires en Amérique latine
Chapitre XX. La Société générale et les affaires du Pérou
Chapitre XXI. La Société générale à l’assaut de l’Asie ?
Conclusion de la deuxième partie
Troisième Partie : Un bilan de la croissance, de la puissance et de la compétitivité
Chapitre XXII. La position de la Société générale sur la place
Chapitre XXIII. La Générale confrontée à une crise de confiance en 1913-1914
Chapitre XXIV. Une crise du modèle économique de la Société générale ?
Chapitre XXV. Les équipes de gestion financière
Chapitre XXVI. La maîtrise du bilan : liquidité, solvabilité, profitabilité
Chapitre XXVII. Essai d’appréciation de la compétitivité et de la profitabilité de la Société générale
Chapitre XXVIII. Essai d’appréciation de la performance comparée de la Société générale
Conclusion générale : L’évaluation d’une stratégie et d’un modèle économique
Index général
Liste des légendes
Après son émergence (tome I), la Société générale incarne la deuxième révolution bancaire : elle a une stature de banque de dimension nationale et déploie un vaste réseau d’agences ; elle s’affirme dans le sextet des leaders de la place bancaire de Paris. Cette expansion explique qu’elle se dote d’outils de gestion d’une grande firme bancaire (comptabilité, ressources humaines, immobilier, Inspection générale), sous la houlette d’une direction qui se structure et se diversifie (volume 1). La Générale pratique la banque relationnelle dans les régions grâce à ses agences ; elle devient l’un des leviers de la croissance du capitalisme français dans la deuxième révolution industrielle, en partenaire de grandes entreprises et de noyaux de moyennes sociétés familiales (volume 2). Elle participe à l’expansion de la banque commerciale de crédit et de la banque de négoce, en France ou à l’échelle européenne, grâce à une forte présence à Londres et en Belgique. Elle mobilise l’épargne grâce à son métier de banque de placement de valeurs mobilières et à son insertion dans les syndicats d’émission. Elle duplique son modèle économique en se lançant sur le marché russe, où elle bâtit, à la veille de la guerre, la première banque du pays. Cette histoire en deux volumes repose sur les archives de la Société générale et d’autres banques qu’Hubert Bonin a dépouillées avec intensité.
-
-

A la recherche du temps perdu est considéré comme l’un des plus grands romans de tous les temps. Le livre a aussi la réputation d’être difficile d’accès. François de Combret a lu et relu Proust plus d’un demi-siècle et sa lecture constante a dégagé des idées fortes, des réflexions essentielles, jusqu’à des redondances de l’écrivain. Son Bréviaire est exemplaire d’une vie passée à lire Proust ; une lecture attentive qui a mis en pratique le mot de Valéry : « Proust, l’intérêt de ses ouvrages réside dans chaque fragment ». Le Bréviaire est composé de plus de 3 000 de ces « fragments » qui, classés par ordre alphabétique de mots-clefs, révèlent un secret et subtil réseau de correspondances. La recherche ressemble à une immense cathédrale dans laquelle, d’un bout à l’autre, résonnent et se répondent les échos d’un monde enchanté. « Cette contemplation de l’essence des choses, j’étais maintenant décidé à m’attacher à elle, à la fixer », écrit Proust dans Le temps retrouvé. Le Bréviaire en rend compte.
-

Remerciements
Avant-propos de Philippe Kaenel : la presse satirique en Suisse
Introduction
Première partie
IDENTITÉ ET CHRONIQUE D’UNE REVUE SATIRIQUE ZURICHOISE
1. Genèse et figures
1.1. Décryptage de la fondation et de la vie éditoriale : focus sur Boscovits senior
1.2. La domination Boscovits
1.3. La configuration artistique et sociétale des dessinateurs
1.4. Ambitions voilées et assumées : de la délimitation avec les champs de l’art et de la presse
1.5. Liste et période d’activité des éditeurs et rédacteurs en chef
1.6. Liste et période d’activité des dessinateurs
2. Cycles de vie d’un organe bourgeois à l’identité complexe
2.1. 1875, un premier numéro fixant les choses : maquette, tendance, identité visuelle et commerciale
2.2. 1875-1886 : les années noir et blanc de l’ère Nötzli ou quand la Suisse prime sur le monde
2.2.1. Identité, maquette et technique – On affine
2.2.2. Distribution, politique commerciale et lectorat – Essor
2.2.3. Déclinaisons thématiques d’une tendance stable
2.2.4. Un langage visuel et rhétorique très typé
2.2.5. L’installation d’un appareil allégorique
2.3. 1887-1899 : ouverture, couleur et premier Jugendstil sous l’ère Nötzli
2.3.1. Identité, maquette et technique – Changements techniques et oscillations du titre
2.3.2. Distribution, politique commerciale et lectorat – En avant toute
2.3.3. Thèmes et tendance – Ouverture et modernité
2.3.4. Rhétorique – Continuité et variations
2.3.5. Langage visuel – Jugendstil, Belle Époque et caricature
2.3.6. La constellation allégorique du Nebelspalter – Allégorie, femme et un monde à soi
2.3.7. Les couvertures Jugendstil, l’affirmation d’une identité
2.3.8. En voir de toutes les couleurs
2.4. 1900-1906 : Jugendstil versus Heimatstil – Retour aux fondamentaux
2.4.1. Identité, maquette et technique – Menace sur le cadre au trait
2.4.2. Distribution, politique commerciale et lectorat – Statu quo
2.4.3. Tendance et thèmes – Recentrage
2.4.4. Rhétorique – L’empreinte de la politique
2.4.5. Langage visuel – Acculturation du Jugendstil et recyclage de formules anciennes
2.4.6. La femme, le nu et l’allégorie
2.4.7. Du Heimatstil en couverture – Le Jugendstil helvétique
2.4.8. Les aléas de la couleur
2.5. 1907-1912 : remous, hésitations et révisions
2.5.1. Identité, maquette et technique – Le temps de la refonte
2.5.2. Distribution, politique commerciale et lectorat – Recadrage
2.5.3. Durcissement de tendance et primauté à la politique
2.5.4. Rhétorique – On monte le ton
2.5.5. Victoire du Heimatstil et confinement de l’image à l’illustration satirique
2.5.6. Recul de la représentation féminine et désinvestissement de l’allégorie
2.5.7. La valse des couvertures
2.5.8. Passage définitif à la couleur
2.6. 1913-1921 : l’image en perte et la Première Guerre mondiale
2.6.1. Identité, maquette et technique – Recul
2.6.2. Distribution, politique commerciale et lectorat – Sursauts et fuite en avant
2.6.3. Tendance et thèmes – Repli et ambigüité
2.6.4. Une rhétorique clivée
2.6.5. Le chant du cygne de l’image
2.6.6. Divorce de la femme et de l’allégorie
2.6.7. Dilution de la couleur
Deuxième partie
UN CERTAIN REGARD SUR LE MONDE
3. Regard sur un monde aux déclinaisons plurielles
3.1. Une iconographie du monde 107
3.1.1. 1875-1886 : figures et motifs d’une ouverture a minima
3.1.2. 1887-1914 : déclinaisons d’un univers en expansion et d’une Europe impuissante
3.1.3. 1914-1921 : embrasement et no man’s land d’un univers en perdition
3.2. La Suisse versus Zurich : critique et iconographie
3.2.1. Le face-à-face (helvétique) du Nebelspalter avec Helvetia
3.2.2. L’alliance sacrée ou la Suisse du Nebelspalter
3.2.3. Chronique visuelle d’une ville : Zurich
3.3. La Première Guerre mondiale : la « drôle » de guerre d’une revue
3.3.1. Se situer vis-à-vis d’un conflit étrange
3.3.2. Rire en guerre
3.3.3. Montrer la guerre et renoncer au rire
3.3.4. L’après-guerre : ressassements en images
Troisième partie
CULTURE, ART ET POLITIQUE :
DISCOURIR ET PRENDRE SA PLACE
4. Discours sur l’art
4.1. La question de l’art suisse
4.2. Rendre compte des expositions et régler ses comptes via les expositions
4.3. Le salon caricatural du Nebelspalter ou la critique de la modernité
4.4. Le couple Arnold Böcklin et Ferdinand Hodler
4.5. Plaider et batailler pour la pierre à Zurich : le Kunsthaus et le Musée national suisse
4.6. La maigre réception des mouvements contemporains
5. Emprunts, transferts et autoréférentialité
5.1. Le Nebelspalter, la caricature et les revues illustrées européennes
5.2. S’enrichir du « grand art »
5.3. Le statut très particulier de Arnold Böcklin et Ferdinand Hodler
5.4. Transpositions médiales
5.5. Se citer soi-même plus que de mesure
6. Des affaires de réseaux
6.1. La leçon des archives Nötzli : un éditeur et ses réseaux
6.2. Intrigues suisses et influences françaises dans le monde éditorial: Jean Nötzli, John Grand-Carteret et Cäsar Schmidt
6.2.1. Acte un : correspondance entre Jean Nötzli et John Grand-Carteret de 1880 à 1891
6.2.2. Acte deux : 1897, querelle autour de l’« Europe actuelle »
6.3. Quand politique, art et satire se mêlent : Numa Droz et Jean Nötzli
6.4. Passions d’artistes : Richard Kissling, Evert van Muyden, Henri van Muyden et Jean Nötzli
Conclusion
Bibliographie sélective
Travaux académiques sur le Nebelspalter
Travaux académiques s’appuyant sur le Nebelspalter de manière significative
Publications de vulgarisation sur le Nebelspalter en provenance des éditions du Nebelspalter
Publications de vulgarisation sur le Nebelspalter en provenance d’autres maisons d’édition
Index
Table des illustrations
Crédits photographiques
-
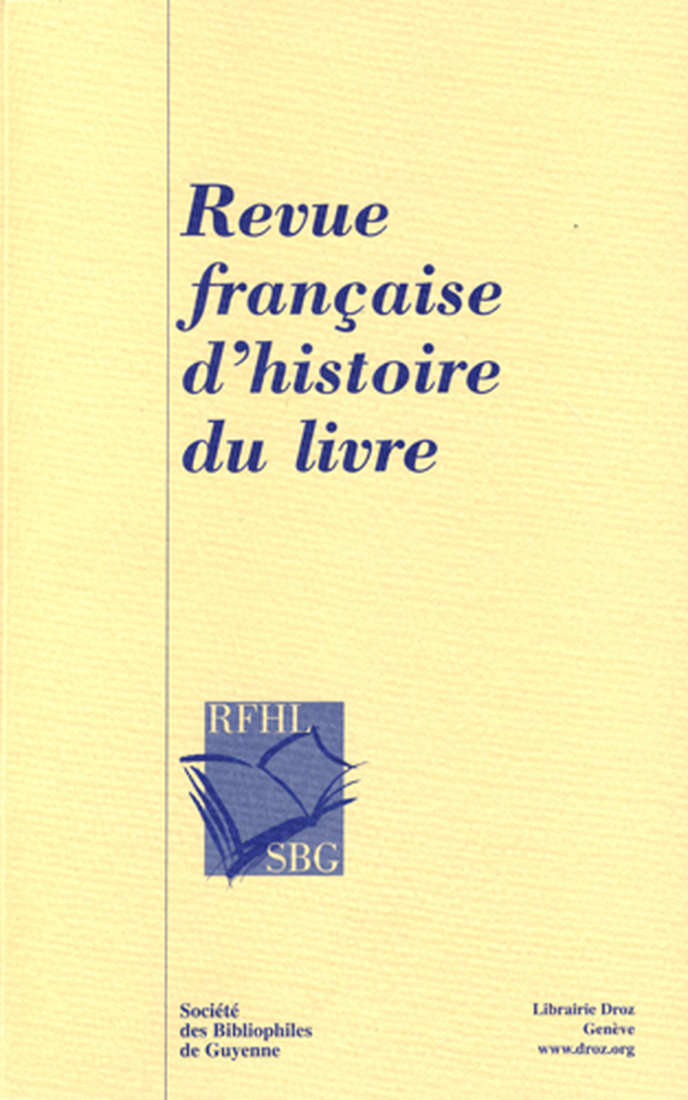
Sommaire: Études - Actes du LXXe colloque de la Fédération historique du Sud Ouest
(Bordeaux, 30 septembre-1er octobre 2017 : Archives, manuscrits et imprimés) - M. NAVARRO CABALLERO, « Les Inscriptions latines d’Aquitaine : les archives de la population romaine d'Aquitaine »; F. LAINÉ, « Nécrologes et obituaires du Sud-Ouest.
Du manuscrit à l'édition »; S. LAVAUD, T.-L. ROUX et A. STELLA, « L'écrit municipal à Agen au Moyen Âge »; S. DRAPEAU, « Instantané d'un chantier hors norme : la comptabilité de l'œuvre de Saint-Michel de Bordeaux (1486-1497) »; J.-P. POUSSOU, « De l'importance et du rôle de l'information durant les grandes crises politiques anglaise et française du milieu du XVIIe siècle »; G. TAFFIN, « Modalités de conservation et enjeux actuels des archives des juges-consuls »; L. COSTE, « Le mémorandum d'Antoine Gautier : de l'écriture à la diffusion »; F. CADILHON, « Thérèse Desqueyroux : François Mauriac et ses voisins »; S. MIQUEL, « Inventaires floristiques et archives botaniques
en Périgord »; S. HOLGADO et C. JACOBS, « Gardien du temps ou l'éternel recommencement, du XVIIIe siècle à nos jours : une bataille impossible contre les misères du temps »; M. AGOSTINO, « La préservation d'un document exceptionnel
au cinéma. Le cas de deux films, Le Nom de la rose et Citizen Kane » ; A. ROQUAIN, « À propos de deux livres ayant appartenu à Lope de Vega : Il gentilhuomo et Avvertimenti morali de Muzio / Épitomé de Florus et Histoire de Polybe » ; F. ROUGET, « La réception éditoriale posthume des Œuvres de Philippe Desportes (1611-1621) »; H. VAN DER LINDEN, « Un ensemble de rares publications éphémères françaises du XVIIe siècle (Harvard, Houghton Library, *88-474a) : aperçu et inventaire »; M. JAOUHARI, « Les manuscrits arabes du général Daumas (1803-1871) » - II. Variétés - Lyse SCHWARZFUCHS, « Devises et marques dans le livre imprimé en terre francophone au XVIe siècle : Paris, Lyon, Genève »; A. GALLET, « La monographie botanique » Comptes rendus.
-

Table des matières
INTRODUCTION
CHAPITRE PREMIER. BOUCHE BÉE
CHAPITRE II. DESSERRER L’ANGOISSE ?
CHAPITRE III. SAS (SUR LE RESSASSEMENT)
Spirales et asymptotes
Compulsion de répétition et double bind
Apophase
Face à l’ineffaçable
Pour ne pas finir
CHAPITRE IV. DANS L’APORIE DE L’ÉCRITURE
Paradoxes circonstanciels, et paradoxes ludiques
Le paradoxe pathétique (Rousseau), et son refoulement philosophique et social
L’écriture impossible (Flaubert), et le droit de se contredire (Baudelaire)
Dans le doute du Jeu suprême (Mallarmé)
La littérature vs la littérature
Un mot sur d’autres arts
CHAPITRE V. À L’ÉPREUVE DU NIHILISME
Nihilismes théologiques (1761, 1799)
Nihilismes politiques et révolutionnaires (XIXe siècle)
Nihilismes pessimistes et ontologiques (XIXe siècle)
Typologie des nihilismes (chez Nietzsche)
Quelques nihilismes post-nietzschéens (XXe siècle)
Traumatismes historiques et nihilismes (XXe siècle)
« Après le Déluge », ou : en finir avec le rien ?
CHAPITRE VI. DE LA JUBILATION
Approche bergsonienne (avec Baudelaire, Flaubert, Proust)
Approche freudienne (avec André Breton, et quelques autres)
Approche lacanienne (avec Sartre)
Approche barthésienne (avec Severo Sarduy)
Approche spinozienne (Misrahi et Comte-Sponville, avec Gide et Le Clézio)
Approche nietzschéenne (Onfray avec La Mettrie, Sade, Bataille, Sollers)
BIBLIOGRAPHIE
Références éditoriales
Bibliographie critique
INDEX
Il y a une qualité de la littérature moderne qui mérite d’être soulignée : l’obstination. Ecrire est un travail sans fin, inachevable, toujours en résistance face aux obstacles internes (les autocontradictions de la littérature) et externes (les grands traumatismes historiques). Ce livre plonge son lecteur dans les paradoxes d’une écriture qui s’obstine contre l’impossibilité d’écrire. Nous y voyons la littérature affronter la stupeur, l’angoisse, le ressassement, le nihilisme, soit qu’elle en fasse l’expérience jusqu’à s’y enfoncer elle-même, soit qu’au contraire elle tente d’y échapper. Car l’enjeu pour la littérature est bien un dépassement de la négativité, et l’avènement d’une parole jubilatoire. En effet, la fonction de la littérature n’est pas, ou pas seulement, de ressasser le malheur, mais plutôt d’amplifier le bonheur – et, cela, au bénéfice du lecteur : notre pratique patiente de la lecture n’est-elle pas aussi ce qui constitue obstinément la littérature ?
-

La dissertation : un exercice scolaire au service de la formation de l’élite masculine ? A Genève et plus largement en Suisse romande, le processus de fabrication de la dissertation est lié en réalité au développement des écoles secondaires de jeunes filles qui s'organisent dès 1848 autour d’une culture moderne, dans laquelle le français prend le statut de voûte, la dissertation, celui de clé. A la suite des premières remises en cause de l’exercice à partir de 1955 pour son caractère élitiste, l'exercice ne disparaît pas. Il est cependant reconfiguré en profondeur dès 1980, en particulier dans la filière non gymnasiale désormais mixte : d'un moyen d'évaluation de la culture générale de l'élève, la dissertation devient progressivement un genre argumentatif permettant d'évaluer la culture scolaire littéraire acquise par l'élève dans le cours de français. Cette étude montre ainsi comment la dissertation en tant qu’exercice scolaire apparaît et se développe dans le cadre d’un projet politique précis, la démocratisation de l’enseignement, impliquant la mise en place d’un nouveau modèle de formation, la culture générale, dans lequel le français joue tout au long du XXe siècle le rôle de fer de lance.
-
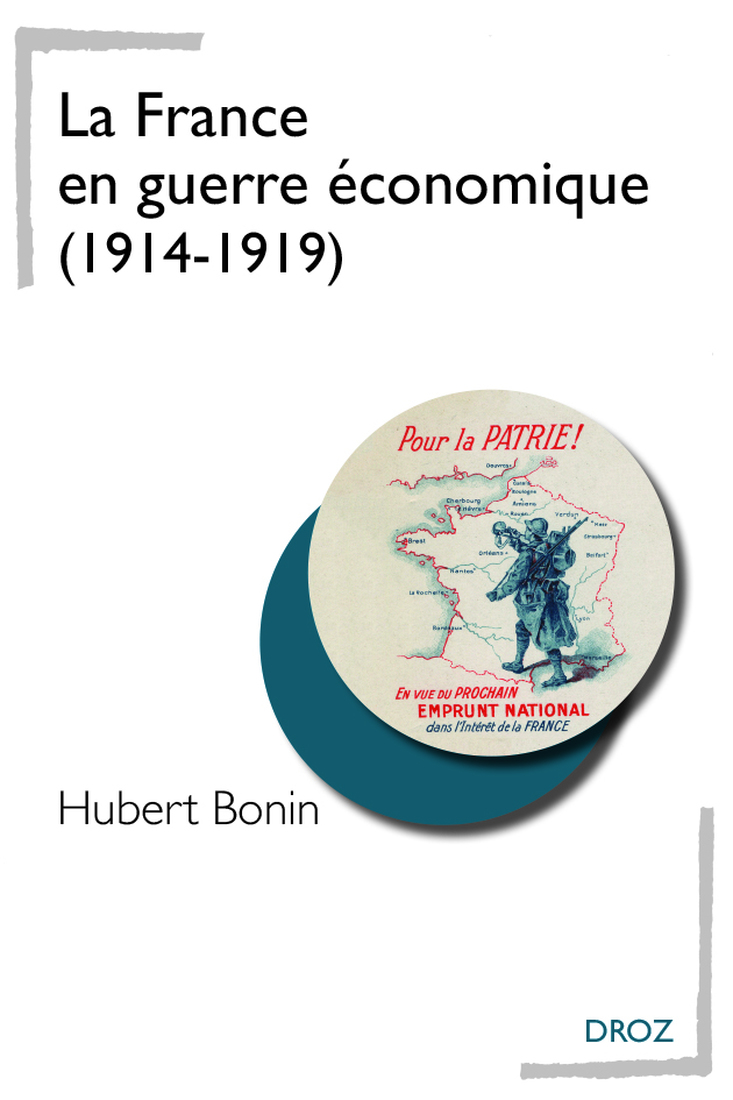
TABLE DES MATIÈRES
Avant-Propos, Lieutenant-colonel Rémy Porte
Introduction générale
1. De la guerre matérielle ou industrielle aux esprits en guerre
2. Une rupture avec l’esprit d’ouverture
3. Des entrecroisements incessants
4. Tout serait dit ou écrit ?
5. Un nouveau type de guerre : de la guerre totale à la guerre économique
6. Des systèmes productifs sectoriels et locaux à l’appareil économique d’Etat ?
7. Des héros ou de grandes figures de la guerre économique
8. L’argent, nerf de la guerre
Première partie
La guerre industrielle de la Nation
Chapitre premier. Bordeaux, capitale de la mobilisation industrielle (20 septembre 1914)
1. Bordeaux au coeur des choix stratégiques en septembre 1914?
2. La mobilisation industrielle classique
3. Des débats autour de la stratégie militaire française
A. Edmond Buat, un témoin clé
B. Une inflexion sous la pression des événements
4. Trois réunions d’industriels à Bordeaux
5. Le lancement de la guerre industrielle
Conclusion
Chapitre II. La montée en puissance de la machine de guerre industrielle : vers une économie mixte (1914-1919)
1. Une maturation trop lente de l’outil productif (de l’automne 1914 à l’été 1916)
A. Les blocages de l’été 1914
B. Les premières réactions après la prise de conscience de l’impasse économique
C. La persistance de blocages insidieux
D. L’enjeu de la qualité
2. La mise en place d’une administration de l’économie de guerre
3. Une économie mixte de guerre, entre politiques et patrons
4. Une fonction de coordination entre dirigisme et liberté d’entreprendre
A. Stimuler les entreprises
B. La cristallisation des organismes patronaux
5. Une puissance industrielle dualiste
Conclusion
Chapitre III. La montée en puissance du système productif de guerre articulé autour de l’artillerie
1. Les premières étapes du déploiement de l’industrie de l’artillerie (1914-1916)
A. Le bond des besoins entre 1914 et 1916
B. L’essor de l’artillerie lourde
C. La mutation des mortiers
D. La définition d’un schéma d’ensemble en juillet 1916
E. L’artillerie n’est pas la panacée : les exemples de la Somme et du Chemin des Dames en juin-juillet 1916 et avril 1917
2. La guerre du feu intense : la montée en puissance
A. Une nouvelle impulsion donnée à l’artillerie en juin-juillet 1917
B. Les ultimes productions d’artillerie en 1918
3. La double guerre des productions : faire du neuf, entretenir l’ancien
4. La structuration d’un système productif articulé autour de l’artillerie
A. Les arsenaux au coeur de la guerre industrielle
B. Des établissements géants en région lyonnaise
C. La vallée de la Basse-Seine dans la guerre industrielle
D. Thomson-Houston, exemple emblématique de la mobilisation du secteur privé
5. L’ingénierie industrielle en levier de l’efficacité
A. Les aléas de la montée en puissance des chaînes de production
B. L’enjeu des machines-outils
Conclusion
Chapitre IV. Vers un déluge d’obus
1. Produire des obus en masse
A. Une montée en puissance difficile
B. Le système productif des obus de plus en plus structuré
2. Les arsenaux dans la guerre des obus
3. Le secteur privé mobilisé pour les obus
A. L’essaimage de l’industrie des obus
B. Des entreprises reconverties dans les fabrications d’artillerie.
C. Un mini-système productif en région parisienne
D. L’essaimage au sein de mini-systèmes productifs régionaux..
4. Un déluge d’obus
5. Les retombées de la guerre des obus sur des branches latérales
A. Les mécaniciens au service de la guerre des obus
B. Les emballeurs, rouages modestes mais essentiels
Chapitre V. Les batailles industrielles en 1916 : enjeux, initiatives et blocages
1. Les conséquences immédiates de la bataille de Verdun
2. La bataille de l’industrie des armements
3. La mise en oeuvre du programme de mai-juin-septembre 1916
4. Innover au son du canon en 1916
A. L’entrée dans l’ère des véhicules de guerre
B. L’importance des armements légers
C. Le décollage de l’équipement aéronautique
5. Une économie mixte équilibrée ?
Conclusion
Chapitre VI. L’élargissement de la diversité des productions d’armements
1. L’enjeu des armements légers
2. L’enjeu des cartouches
3. L’enjeu des grenades à main
4. L’enjeu des mitrailleuses
5. L’enjeu des chars : une lente maturation stratégique
A. Des cuirassés terrestres en appui aux assauts de l’infanterie
B. La percée des chars d’assaut
C. Le triomphe des chars légers type Renault
D. Une usine Berliet pour des chars
E. Une esquisse de bilan technique de la guerre mécanique
6. L’enjeu des innovations en optique
Conclusion
Chapitre VII. Schneider en guerre
1. Déjà un complexe militaro-industriel à la veille de la guerre
A. La poursuite des programmes d’artillerie
B. La cristallisation d’un bloc amont-aval
2. La mobilisation industrielle en 1914
A. La mise en place de l’action de guerre
B. L’afflux des commandes de guerre
3. La poussée de l’industrie lourde en 1915-1918
A. Le renforcement du pôle du Creusot
B. Schneider glisse plus encore vers la Normandie
4. Schneider dans la guerre de l’artillerie
5. Schneider entraînée par la guerre des obus
6. Schneider face à la crise des transports
7. La révolution électrique accélérée par la guerre ?
8. Schneider engagée toujours plus dans l’industrie des transports..
9. Innover dans la gestion de firme
A. Un état-major civil dans la guerre
B. L’évolution du mode d’impulsion et de contrôle
C. Une gestion plus fine des ressources humaines
10. Considérations sur la situation bilancielle de Schneider au sortir de la guerre
Conclusion
Annexe. Discours d’Albert Thomas chez Schneider en avril 1916 197
Chapitre VIII. Une guerre économique discrète, en amont de la production d’armements
1. Une course à l’acier
2. Un équilibre délicat entre importations et production nationale.
3. Une course au charbon
4. L’énergie électrique dans la guerre industrielle
A. Les investissements en hydroélectricité
B. Vers une économie mixte de l’électricité
5. La bataille de l’électrométallurgie
6. Le bond de la chimie en guerre
A. L’émergence d’une chimie de guerre
B. La chimie classique mobilisée : la chimie des poudres
C. Surmonter la dépendance initiale vis-à-vis des technologies allemandes
D. La bataille de la production d’explosifs et de gaz de
combat : la percée de la chimie des gaz
E. Les investissements en usines électrochimiques
F. Saint-Gobain en action
7. Produire pour la vie quotidienne des soldats
Conclusion
Chapitre IX. Une course aux moyens de transport
1. L’enjeu des camions de guerre
2. Berliet, fer de lance des camions
3. La course aux navires de fret
Deuxième partie
La guerre de l’air gagnée aussi dans les usines
Chapitre X. La machine de guerre aéronautique en 1914-1919
1. La conception de programmes aéronautiques
A. Une esquisse de système d’aéronautique en 1914-1915
B. Les cafouillages de l’hiver et du printemps 1916
C. Une réelle mutation au tournant de 1917
2. L’essor de l’industrie aéronautique
A. Les ramifications de l’industrie aéronautique
B. Les vibrations d’un système productif en décollage au second semestre 1914
C. Une courbe ascendante affirmée en 1915-1916
D. Une belle puissance de vol pour les conventions et contrats en 1917
E. Le boum de la production
3. Un esprit d’entreprise et d’innovation
4. Lyon pôle de production aéronautique
5. La densification et la diversification de la filière amont
6. Sans cesse innover tout en amplifiant la production
Conclusion
Chapitre XI. L’Ouest parisien, coeur de l’aéronautique de guerre
1. Hanriot, un pionnier mobilisé par l’effort de guerre
2. Morane-Saulnier à Puteaux, des expérimentations aux séries
A. Des marchés de part et d’autre de la déclaration de guerre
B. L’explosion des commandes d’avions
3. La montée en puissance de Caudron entre Issy-les-Moulineaux et Lyon
A. Caudron, régulièrement au coeur des marchés publics
B. D’énormes contrats en 1918
4. Voisin, un acteur pluraliste de la guerre aérienne
5. A Suresnes, la seconde aventure de Louis Blériot
6. Nieuport, spécialiste des ... Nieuport, à Issy-les-Moulineaux
7. Le décollage de Breguet à Villacoublay
8. Une esquisse de bilan de la production des leaders de l’Ouest parisien
9. Une floraison d’entrepreneurs en aéronautique de guerre
A. Une première aventure militaire pour Marcel Bloch à Suresnes
B. Un avioniste éphémère mais efficace à Levallois, Savary & De La Fresnaye
C. Edmond de Marçay, de la mécanique aux SPAD à Paris 294
D. Lioré & Olivier, un sous-traitant destiné à une belle aventure après-guerre
E. Farman, des équipements aux avions
F. De petits fabricants insérés au fil de l’eau dans les commandes aéronautiques
10. L’éclosion d’un mini-système productif local
A. L’essaimage de l’industrie aéronautique autour du pôle de l’Ouest parisien
B. Des fournisseurs de roues d’avion
Conclusion
Chapitre XII. Bordeaux, nouveau pôle de l’aéronautique en 1914-1919
1. Des entreprises descendues de Paris
A. La mobilisation pour produire des avions
B. Le boum de la sous-traitance en provenance de la région parisienne
2. La mobilisation d’entreprises girondines
A. Des ateliers dans l’agglomération bordelaise
B. Des ateliers sur le bassin d’Arcachon
C. L’industrie pétrolière mobilisée
Conclusion
Chapitre XIII. La double montée en puissance des moteurs d’avion
1. La double montée en puissance des moteurs
2. Des moteurs Rhône fabriqués à Paris
3. Une vedette de l’aéronautique lyonnaise : Salmson
A. L’engouement pour les moteurs Salmson
B. Des équipements variés
C. Des avions Salmson s’envolent
Chapitre XIV. La mobilisation des mécaniciens de l’Ouest parisien pour les moteurs d’avion
1. Clément-Bayard, de l’automobile à l’aviation à Levallois-Perret
2. Clerget-Blin, un motoriste en essor à Levallois-Perret
3. Hispano-Suiza, géant de l’industrie des moteurs d’avion à Bois-Colombes
4. Lorraine-Dietrich, grand des moteurs pour hydravions à Argenteuil
5. Mayen, un motoriste méconnu à Suresnes et Clichy
6. Le système productif spécifique des motoristes
7. Le sort des motoristes en jeu au tournant de 1919
Conclusion
Troisième partie
La guerre des banquiers
Chapitre XV. Le soutien de l’effort de guerre des entreprises par les banques françaises en 1914-1918
1. Une première étape : l’assouplissement du moratoire
2. Les affaires de crédit internationales au service de l’industrie de guerre
A. Les banques engagées dans de grands crédits transatlantiques
B. Les banques engagées dans les crédits transatlantiques du groupe Schneider
C. De petits crédits complémentaires
3. Les banques et le montage de crédits européens
A. Des crédits scandinaves
B. Une série de crédits hollandais
C. Des emprunts en Suisse
D. Un crédit espagnol de douze tranches
4. Des banques en guerre au financement de l’économie de la paix
Chapitre XVI. Les banques dans la propagande financière et patriotique
1. Communication, confiance et persuasion
2. Collecter les actifs disponibles
3. Une machine à placer les bons d’Etat
4. Les banques, actrices du placement des grands emprunts de guerre
A. Un emprunt de paix émis juste à temps (juillet 1914) : la prise de conscience d’un besoin de propagande
B. Le premier emprunt de guerre
C. Le deuxième emprunt de guerre
D. Le troisième emprunt de guerre
E. Le quatrième emprunt de guerre
5. L’art de la propagande et la propagande par l’art
6. La propagande en action sur le terrain
A. Des campagnes d’affichage
B. La prospection des clients
7. Une évaluation de la contribution à la mobilisation de l’épargne
Conclusion
Chapitre XVII. La Société générale mobilisée dans la Première Guerre mondiale
1. L’inflexion de la stratégie internationale de la Société générale
A. Une vive croissance dans les années 1890-1910
B. Un modèle stratégique disloqué par la Première Guerre mondiale
C. De bonnes occasions de rebond à l’international
2. La mobilisation de la Société générale dans la guerre financière
3. L’engagement en direct de la Société générale dans le soutien du Budget de guerre
4. L’implication de la Société générale dans la machine industrielle de guerre
5. Financer les importations par le négoce portuaire
Conclusion
Quatrième partie
La guerre de la logistique et du négoce
Chapitre XVIII. Worms en 1914-1918 : gérer la logistique en guerre internationale
1. Une maison représentative du capitalisme familial
2. L’économie maritime de Worms confrontée à la guerre
A. Les aléas banals de la guerre
B. Les incertitudes quant aux disponibilités de la flotte de commerce
C. Worms dans la guerre sous-marine
D. Une centralisation croissante
3. Worms, l’un des pivots de l’axe franco-britannique
4. Worms et l’économie du ravitaillement de guerre
5. Vers la décentralisation de la manutention et du transit portuaires
Conclusion
Chapitre XIX. Des maisons de négoce euro-africaines confrontées à la Guerre de 1914-1918
1. Les turbulences provoquées par la guerre
A. La crise des transports maritimes
B. La crise des ponctions de cadres et d’employés
2. Une inflexion provisoire du système productif euro-africain ?
A. Les tensions de l’économie de marché
B. Vers une économie mixte ?
3. Vers une reconfiguration du modèle marchand euro-africain ?
A. Un match entre forts et faibles ?
B. Le redémarrage des affaires en 1916-1918 avant un boum en 1919-1920
C. L’argent du négoce de guerre
4. Préparer l’après-guerre : une esquisse d’industrialisation ?
5. A l’assaut des ex-colonies allemandes ?
Conclusion
Chapitre XX. Le canal et la Compagnie de Suez face aux défis géopolitiques, maritimes et économiques de la Première Guerre mondiale
1. Le canal, de la coopération d’affaires à un enjeu géopolitique
2. Les effets économiques de la guerre sur l’entreprise de Suez
3. Le canal de Suez en guerre
A. L’isthme de Suez comme enjeu géopolitique
B. La défense immédiate du canal de Suez
C. L’isthme de Suez comme un levier pour des offensives britanniques en Palestine
Conclusion
Conclusion générale
1. Réflexions sur la République économique
2. Réflexions sur le temps de l’action des entreprises
3. Quelle République économique ?
4. La guerre de l’innovation
A. L’innovation industrielle
B. L’innovation bancaire
5. L’enjeu de la puissance économique : des batailles économiques de guerre à la bataille économique dans la paix
Index
Liste des légendes
Afin de répondre aux demandes de plus en plus importantes et répétées des armées, l’industrie s’érige en vaste front de l’arrière. Des usines se reconvertissent ou sont créées ; les grandes entreprises deviennent des « firmes-pivots » structurant, au sein de chaque branche d’activité, de grands établissements, des pme et des sous-traitants. Des flux d’innovations se répandent dans l’artillerie, l’aéronautique, les chars, les méthodes de fabrication. La pénurie de produits de base, de charbon, de moyens de transport et de main-d’œuvre enraye ces processus ; une économie administrée se cristallise pour les surmonter. Il faut aussi financer les investissements et les besoins courants des entreprises et de la commande publique, d’où le rôle croissant des banques. Un enjeu clé est d’affûter la compétitivité des systèmes productifs nationaux et locaux afin de contrecarrer la puissance industrielle allemande au cœur de la guerre, puis de préparer la nouvelle Europe économique de la paix.
-
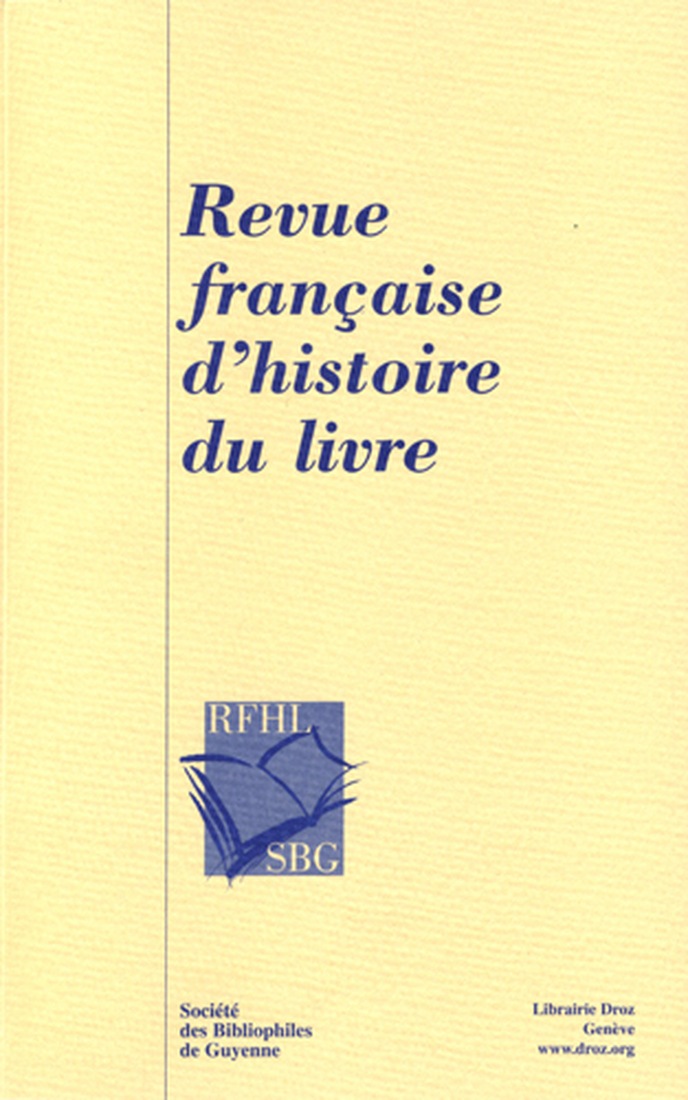
Sommaire
I. Etudes - Samuel GRAS, "L'atelier de Jean Poyer à Madrid. Un missel au temps des fiançailles de Charles VIII et Marguerite d'Autriche"; Annalisa MASTELOTTO, "Au fil des pages: les notes marginales de l'exemplaire de travail de la Bibliotheca Universalis de Gesner consacrées aux auteurs italiens"; Evelien CHAYES, "Bibliothèques bordelaises à l'époque de Montaigne"; Dominique VIDAL, "Le Théâtre d'Agriculture et mesnage des champs, d'Olivier de Serres dans les catalogues de ventes de bibliothèques au XVIIIe siècle, de Jacques-Auguste de Thou à Jean-Baptiste Huzard"; Peter NAHON, "Un regard bordelais sur le rite comtadin en 1847, assorti de quelques notes sur la disparition de celui-ci"; Michel WIEDEMANN et Pierre COUDROY DE LILLE, "Les hommes illustres de Plutarque à nos jours: à propos d'une collection de François Séraphin Delpech"; Christophe BLANQUIE,: "L'érudit, l'évêque et le ministre: le premier Tamizey de Larroque"; Xavier ROSAN, "L'écrivain Louis Emié (1900-1967) et les arts"; Nathalie DIETSCHY, "Le livre d'artiste: au-delà de la page à l'ère digitale" - II. Variétés - André GALLET, "Corisande, Henri de Navarre et Montaigne"; Gilles DUVAL; "Registre de sommet et Cartes de visite, des imprimés parfois négligés: l'exemple du Pic Long (3.192 m), 1928-1939".